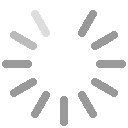Publié le 02/07/2025 - Article rédigé pour Batiactu par Rai d'Action
Conjoint du chef d’entreprise : de qui parle-t-on ?
Dans les entreprises du bâtiment, il n’est pas rare que le conjoint du dirigeant participe à l’activité quotidienne, que ce soit à l’atelier, sur les chantiers ou dans la gestion administrative. Mais avant même de s’interroger sur le statut à adopter, il convient de bien définir à qui s’applique ce cadre juridique.
Le
conjoint au sens du droit du travail et de la sécurité sociale désigne toute personne unie au chef d’entreprise par :
-
le mariage,
-
le PACS,
-
vivant en concubinage notoire.
Toutefois, la législation distingue ces formes d’union, notamment en matière de droits sociaux.
Le mariage et le PACS ouvrent l’accès aux trois statuts possibles (collaborateur, salarié ou associé), tandis que le concubin n’a pas accès au statut de conjoint collaborateur, faute de reconnaissance légale équivalente.
Sont concernées principalement les
entreprises individuelles, les
sociétés unipersonnelles (EURL, SASU), mais aussi les
SARL ou autres formes de sociétés où le chef d’entreprise détient une participation majoritaire. Le secteur du bâtiment est particulièrement touché, car bon nombre de ces entreprises sont à taille humaine, avec une implication familiale forte.
Enfin, pour qu’un statut soit déclaré, il faut
une participation régulière et effective du conjoint à l’activité. Il ne s’agit pas d’un coup de main ponctuel ou d’une présence occasionnelle, mais bien d’un travail réel, durable et non déclaré comme tel. C’est précisément cette situation que la loi entend encadrer depuis 2005, afin de protéger les droits du conjoint actif dans l’entreprise.
L’obligation de choisir un statut depuis 2005
Depuis la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, tout chef d’entreprise dont le conjoint participe de manière régulière à l’activité est
tenu de déclarer son statut. Cette obligation vise à éviter les situations floues, où le conjoint travaille sans être protégé, ni reconnu officiellement. Elle concerne tout particulièrement les entreprises du bâtiment, souvent familiales, où le conjoint est impliqué sans cadre juridique clair.
Cette déclaration est
obligatoire dès lors que le conjoint exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise, même à temps partiel. Cela inclut aussi bien la gestion administrative, la comptabilité, que des tâches plus opérationnelles sur chantier ou en atelier. L’obligation concerne les
conjoints mariés ou pacsés. En revanche, les concubins ne sont pas visés par cette formalité, même s’il est fortement recommandé d’officialiser toute collaboration régulière via un contrat de travail ou un statut d’associé.
Le choix du statut (collaborateur, salarié ou associé) doit être déclaré auprès du
Centre de Formalités des Entreprises (CFE) au moment de l’immatriculation ou en cours d’activité. Cette déclaration permet d’assurer une
couverture sociale au conjoint et de prévenir les litiges liés au travail dissimulé.
En cas de
non-déclaration, l’entreprise s’expose à plusieurs risques :
-
Une requalification en travail dissimulé, avec redressements de cotisations sociales à la clé ;
-
L’absence de protection sociale pour le conjoint, notamment en cas de maladie, d’accident ou de retraite ;
-
Des difficultés juridiques en cas de séparation, décès du dirigeant ou dissolution de l’entreprise.
La déclaration d’un statut n’est donc pas une simple formalité : c’est une
protection essentielle, tant pour le conjoint que pour l’entreprise.
Les trois statuts possibles pour le conjoint
Le chef d’entreprise dont le conjoint participe régulièrement à l’activité doit choisir entre trois statuts :
collaborateur,
salarié ou
associé. Chacun présente des conditions spécifiques, des droits différents et des impacts sur la protection sociale.
1. Le conjoint collaborateur
Ce statut est réservé aux
conjoints mariés ou pacsés, travaillant
sans rémunération dans une entreprise
de moins de 20 salariés. Il est accessible uniquement si l’entreprise est exploitée en nom propre ou sous forme de SARL/EURL dans laquelle le conjoint n’est pas associé.
Le conjoint collaborateur peut participer à la gestion courante, à la comptabilité, à la relation clientèle ou à la coordination de chantier, mais n’a pas le droit de signer au nom de l’entreprise.
Ce statut donne droit :
-
à une protection sociale minimale (maladie, maternité, retraite de base) ;
-
à une assurance vieillesse, avec cotisations réduites, mais droits moindres ;
-
à une responsabilité non engagée, sauf s’il agit au nom du chef d’entreprise.
2. Le conjoint salarié
Le conjoint peut être employé par l’entreprise en tant que
salarié, sous réserve de remplir les conditions classiques : contrat de travail, lien de subordination, rémunération réelle. Ce statut est ouvert aux
conjoints mariés, pacsés ou concubins.
Avantages :
-
Bénéfice complet du régime général de la sécurité sociale (maladie, retraite, prévoyance, chômage) ;
-
Possibilité d’accéder à des droits au chômage en cas de rupture du contrat ;
-
Respect de l’ordre hiérarchique avec un emploi clairement défini.
Ce statut implique un coût plus élevé pour l’entreprise (cotisations sociales), mais il est le plus protecteur pour le conjoint.
3. Le conjoint associé
Enfin, le conjoint peut choisir de devenir
associé dans la société (SARL, SAS, etc.) en y apportant des fonds ou un bien, ce qui lui donne des droits de vote et une part des bénéfices. Il peut être actif ou non dans l’entreprise.
Selon son rôle, il bénéficiera :
-
Soit du régime général s’il est salarié dans la société,
-
Soit du régime des indépendants s’il exerce une fonction de gestion (notamment en tant que co-gérant).
Ce statut est adapté lorsque le conjoint souhaite s’impliquer durablement et disposer d’un pouvoir de décision. Il est aussi utile pour organiser la transmission de l’entreprise au sein du couple.
Comparatif des statuts : avantages et inconvénients
Afin de faire le bon choix du statut du conjoint du chef d’entreprise, voici un tableau permettant de reprendre les différents critères ainsi que les avantages et inconvénients de chacun des 3 statuts :
|
Critères |
Conjoint collaborateur |
Conjoint salarié |
Conjoint associé |
|
Conditions d’accès |
Marié ou pacsé, entreprise < 20 salariés, non rémunéré |
Tous types d’union, contrat de travail, rémunération |
Tous types d’union, participation au capital |
|
Type d’activité |
Participation régulière (gestion, administratif) |
Activité salariée avec lien de subordination |
Activité ou non, selon implication dans la société |
|
Protection sociale |
Régime social des indépendants (RSI/SSI), limitée |
Régime général complet |
Selon rôle : RSI (gérant) ou régime général (salarié) |
|
Retraite |
Droits limités, possibilité de cotisation facultative |
Droits complets (base + complémentaire) |
Variable selon statut social dans l’entreprise |
|
Chômage |
Pas de droit au chômage |
Oui, en cas de rupture du contrat |
Non, sauf si également salarié |
|
Rémunération |
Non rémunéré |
Rémunération versée avec fiche de paie |
Dividendes ou rémunération selon rôle |
|
Pouvoir de décision |
Aucun pouvoir décisionnel |
Aucun (sauf dans le cadre d’une fonction définie) |
Droit de vote en AG, décisions stratégiques possibles |
|
Avantages |
Cotisations réduites, simplicité administrative |
Protection complète, accès au chômage |
Transmission facilitée, implication dans les décisions |
|
Inconvénients |
Faible protection sociale, aucun revenu |
Coût plus élevé pour l’entreprise |
Engagement financier, responsabilité potentielle |
|
Idéal si… |
Aide ponctuelle ou activité légère |
Implication active et régulière |
Volonté de participer à la gouvernance ou transmettre |
Conseils pratiques pour bien choisir le statut du conjoint
Le choix du statut du conjoint du chef d’entreprise ne doit jamais être fait à la légère. Il engage non seulement les droits sociaux du conjoint, mais aussi les responsabilités de l’entreprise.
Voici quelques clés de réflexion pour guider cette décision.
Évaluer le rôle réel du conjoint
Avant toute chose, il convient d’
analyser objectivement l’implication du conjoint dans l’activité. Travaille-t-il régulièrement ? Participe-t-il à la gestion, à la comptabilité, aux devis, ou intervient-il aussi sur les chantiers ? Ce bilan permet de distinguer une simple aide ponctuelle d’un engagement professionnel durable, qui justifie un statut déclaré.
Anticiper les évolutions de l’activité et de la vie personnelle
Certaines situations peuvent évoluer : développement de l’entreprise, départ en retraite du chef d’entreprise, séparation, décès… Il est donc important de choisir un statut qui
protège le conjoint sur le long terme, notamment en matière de retraite, de droits à la sécurité sociale ou de transmission.
Par exemple, un conjoint salarié bénéficiera de
droits au chômage, alors qu’un conjoint collaborateur non rémunéré n’aura aucun filet de sécurité en cas de rupture avec l’entreprise.
Se faire accompagner pour sécuriser le choix
Il est fortement recommandé de
consulter un expert-comptable ou un avocat pour évaluer les conséquences fiscales, sociales et patrimoniales du choix de statut. Ces professionnels peuvent aussi optimiser la situation du couple en tenant compte du régime matrimonial, des revenus du foyer, ou encore du projet de transmission de l’entreprise.
Mettre à jour les déclarations et contrats
Une fois le statut choisi, il est impératif de le
déclarer officiellement auprès du Centre de Formalités des Entreprises (CFE) et de conserver tous les justificatifs (contrat de travail, fiche de paie, statuts modifiés, etc.). En cas de changement de situation, il convient de
mettre à jour cette déclaration sans tarder.
Article rédigé pour Batiactu par Rai d'Action.