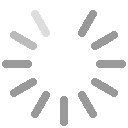Publié le 14/05/2025 - Article rédigé pour Batiactu par Rai d'Action
Qu’est-ce qu’une malfaçon dans le bâtiment ?
D’un point de vue juridique, la malfaçon est un manquement à l’obligation de résultat à laquelle est tenu un entrepreneur dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage. Cela signifie que le résultat final, l’ouvrage livré, doit
correspondre aux attentes définies dans le contrat, mais aussi aux normes en vigueur.
En pratique, une malfaçon peut se manifester par :
-
des défauts de planéité ou d’alignement ;
-
des infiltrations d’eau liées à une mauvaise étanchéité ;
-
des fissures anormales sur un mur ou une façade ;
-
une pose non conforme de carrelage, d’électricité, de plomberie, etc.
Certaines malfaçons sont immédiatement visibles à la réception des travaux. D’autres ne se révèlent qu’avec le temps, ce qui complique leur traitement.
Malfaçon, non-conformité, vice caché : faire les distinctions
Il est important de différencier plusieurs notions qui sont souvent confondues :
-
La malfaçon implique une mauvaise exécution des travaux par rapport aux règles de l’art ou aux engagements contractuels.
-
La non-conformité concerne un écart entre l’ouvrage livré et ce qui a été prévu dans les plans ou le devis (par exemple, l'installation d’un matériau différent de celui convenu).
-
Le vice caché désigne un défaut qui rend l’ouvrage impropre à l’usage attendu, sans être visible au moment de la réception.
-
Enfin, le défaut d’entretien, souvent invoqué par les maîtres d’ouvrage, ne relève pas de la responsabilité de l’artisan si l’ouvrage a été correctement livré.
Ces nuances sont déterminantes pour qualifier un litige et identifier les recours possibles. En effet, selon la nature du défaut constaté, les garanties légales applicables ne seront pas les mêmes.
Identifier les responsabilités en cas de malfaçon
En règle générale,
l’artisan ou l’entreprise chargée des travaux est considéré comme responsable des malfaçons qui affectent l’ouvrage, sauf preuve contraire. Cette responsabilité peut également s’étendre aux
sous-traitants s’ils sont intervenus dans la réalisation d’une partie de l’ouvrage, même si le lien contractuel n’existe pas directement entre eux et le client final.
Par ailleurs, la responsabilité peut être partagée si plusieurs intervenants ont contribué au défaut. Il n’est pas rare que des litiges mettent en cause un maçon, un architecte ou un maître d’œuvre en parallèle de l’artisan, notamment sur des chantiers complexes ou mal coordonnés.
L’artisan est tenu à une
obligation de résultat : il doit livrer un ouvrage conforme au contrat et exempt de défaut.
Cette obligation est encadrée par le Code civil, notamment par les articles 1792 et suivants qui définissent les responsabilités des constructeurs d’un ouvrage. En cas de défaillance, la responsabilité peut être engagée, même si l’intention de bien faire est présente.
Les garanties applicables en cas de malfaçon
Le professionnel est également concerné par un ensemble de garanties légales qui couvrent les travaux après leur réalisation.
Voici les principales :
-
La garantie de parfait achèvement : valable pendant un an à compter de la réception des travaux, elle oblige l’artisan à réparer tous les désordres signalés par le client, qu’ils soient apparents ou dénoncés par écrit.
-
La garantie biennale (ou de bon fonctionnement) : elle s’applique pendant deux ans aux éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage (robinetterie, volets, radiateurs, etc.).
-
La garantie décennale : elle couvre pendant dix ans les malfaçons compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Elle s’applique aux travaux lourds de structure, de gros œuvre ou d’étanchéité.
Cas particuliers : la faute d’un tiers ou du maître d’ouvrage
Il arrive qu’une malfaçon
ne soit pas imputable directement à l’artisan. Par exemple :
-
un défaut peut résulter d’une mauvaise étude ou d’un plan erroné fourni par le maître d’ouvrage ;
-
une intervention d’un autre corps de métier peut avoir endommagé une installation correcte ;
-
un produit défectueux livré par un fournisseur peut être à l’origine du désordre.
Dans ces cas-là, il est important pour l’artisan de
documenter précisément ses interventions, notamment à travers des photos, des comptes rendus de chantier, ou encore des réserves formulées au moment de la réception des matériaux ou des plans.
Réagir face à une malfaçon : la bonne démarche
Lorsqu’une malfaçon est signalée, la réactivité de l’artisan est essentielle. Une gestion rapide et professionnelle permet souvent de désamorcer les tensions et d’éviter un contentieux en suivant une démarche bien définie :
-
Analyser le désordre
Avant toute chose, il faut identifier précisément la nature du défaut. Une visite sur site, appuyée par des photos et des constats écrits, permet d’avoir une vision claire de la situation. Si nécessaire, une
expertise amiable peut être envisagée pour objectiver les faits.
-
Engager le dialogue
Dans la majorité des cas, un échange constructif avec le client permet de trouver une solution. L’artisan peut proposer :
-
une reprise des travaux,
-
une réparation ciblée,
-
ou, dans certains cas, un geste commercial.
Ce type d’accord amiable est souvent préférable à un bras de fer juridique.
-
Faire valoir les garanties
Si la malfaçon entre dans le champ des garanties légales (parfait achèvement, biennale ou décennale), l’artisan doit intervenir ou faire jouer son
assurance professionnelle. Il est impératif de déclarer tout sinistre dans les délais pour bénéficier de la couverture.
-
Documenter chaque étape
Pour se protéger, il est essentiel de garder une trace de tous les échanges et actions menées : courriels, lettres recommandées, rapports de visite, photos, devis de reprise, etc. Cette traçabilité est précieuse en cas de litige.
Les recours juridiques possibles pour l’artisan
On pense souvent aux recours des clients lorsqu’une malfaçon est constatée. Pourtant,
les artisans aussi disposent de leviers juridiques pour se défendre, se retourner contre un tiers, ou contester une mise en cause abusive. Ces démarches, bien que parfois longues ou techniques, peuvent éviter des conséquences injustes pour l’entreprise.
Contester une malfaçon non fondée
Il n’est pas rare que des clients invoquent une malfaçon alors que le désordre résulte en réalité :
-
d’un défaut d’entretien,
-
d’une intervention postérieure par un tiers,
-
ou simplement d’une mauvaise utilisation des équipements installés.
Dans ce cas, l’artisan peut
contester la responsabilité qui lui est attribuée. Il est alors conseillé de constituer un dossier technique détaillé (plans, photos, procès-verbaux de réception, bons de livraison, attestations…) pour démontrer que l’ouvrage était conforme lors de sa livraison.
Une
contre-expertise peut être demandée si celle réalisée par le client semble partiale ou incomplète.
Recourir à une mise en demeure
Si un client refuse le dialogue ou bloque un chantier sous prétexte de malfaçons, l’artisan peut envoyer une
mise en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception. Ce document juridique vise à obtenir un règlement (de facture, d’accès au chantier, etc.) ou une clarification du différend. Il marque aussi le début d’une éventuelle procédure judiciaire, en montrant que l’entreprise a tenté une résolution amiable.
Se retourner contre un sous-traitant ou un fournisseur
Lorsqu’une malfaçon provient d’un
travail sous-traité (ex. : carrelage, électricité, plâtrerie), l’entreprise principale peut engager la responsabilité du sous-traitant. De même, si un
matériau défectueux est à l’origine du désordre, l’artisan peut agir contre son fournisseur sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il est donc essentiel, dans ces cas-là, d’avoir conservé tous les documents contractuels (bons de commande, fiches techniques, correspondances).
Les modes alternatifs de résolution des litiges
Avant d’engager une procédure judiciaire, il existe des
solutions de médiation ou de conciliation. Ces dispositifs permettent aux deux parties de se mettre d’accord avec l’aide d’un tiers neutre. Des chambres de métiers, fédérations professionnelles ou assureurs proposent souvent ce type d’accompagnement.
En cas d’échec de ces solutions amiables, le recours au
tribunal judiciaire reste possible. L’artisan devra alors prouver sa bonne foi et démontrer que la malfaçon ne lui est pas imputable, ou qu’il a respecté ses obligations contractuelles.
Prévenir les malfaçons : les bonnes pratiques professionnelles
Si les malfaçons peuvent survenir malgré toute la bonne volonté du professionnel, il est tout à fait possible de
réduire leur fréquence grâce à une organisation rigoureuse.
Un chantier bien cadré commence par un
devis précis, rédigé en bonne et due forme, qui décrit les prestations prévues, les matériaux utilisés, les délais, les conditions de règlement et les éventuelles exclusions. Il doit être signé avant le début des travaux.
Le devis peut être complété par un
contrat d’entreprise pour les chantiers importants, afin de renforcer la sécurité juridique. Ce document doit également préciser le rôle des sous-traitants, les modalités de réception de l’ouvrage et les garanties applicables.
Assurer un suivi de chantier rigoureux
Le suivi des travaux est une étape clé pour éviter les erreurs d’exécution. Cela passe par :
-
des visites régulières sur site,
-
un dialogue constant avec les équipes,
-
une vérification de la conformité à chaque étape,
-
et la mise à jour d’un journal de chantier permettant de garder une trace des décisions et éventuelles réserves.
Cette organisation est particulièrement importante lorsqu’il y a plusieurs corps de métier qui interviennent successivement : elle permet d’éviter les chevauchements, oublis ou incompatibilités techniques.
Se former en continu et rester informé
Les normes de construction évoluent régulièrement. Il est donc essentiel pour un artisan de
se tenir à jour : nouvelle réglementation thermique, règles de sécurité, normes d’installation électrique, etc. Des organismes comme Qualibat, la CAPEB ou les chambres de métiers proposent des
formations techniques ou juridiques utiles.
Une veille active permet aussi d’anticiper les nouvelles obligations légales et de garantir des prestations conformes aux attentes du marché.
Utiliser des matériaux conformes et de qualité
Les malfaçons proviennent parfois de matériaux inadaptés ou non certifiés. Il est donc conseillé de privilégier :
-
des produits labellisés (CE, NF, etc.),
-
des fournisseurs fiables,
-
des fiches techniques à jour.
Il est également important de
contrôler les livraisons et de refuser tout produit abîmé ou non conforme. En cas de doute, des réserves doivent être formulées par écrit au moment de la réception des matériaux.
Article rédigé pour Batiactu par Rai d'Action.