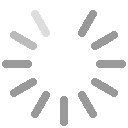Publié le 05/11/2025 - Article rédigé pour Batiactu par Rai d'Action
Contexte et enjeux de la RE 2028 / RE 2031
La RE 2028 et la RE 2031 s’inscrivent dans la continuité de la RE 2020, mais avec un cap nettement plus ambitieux. Les futures versions imposeront des
seuils carbone encore plus bas, un
renforcement des exigences bioclimatiques (Bbio) et une
prise en compte accrue des matériaux biosourcés et de la circularité.
Autrement dit, il s’agit de concevoir des bâtiments à faible impact global, depuis la production des matériaux jusqu’à leur fin de vie.
Les indicateurs de référence seront abaissés, incitant les entreprises à repenser leurs procédés et leurs chaînes d’approvisionnement.
Objectifs environnementaux et économiques
Ces nouvelles exigences répondent à un double impératif :
-
Réduire les émissions du secteur, qui représente près de 40 % de la consommation d’énergie et 25 % des émissions nationales de CO?.
-
Stimuler l’innovation dans la filière, en favorisant les solutions locales, les circuits courts et les filières biosourcées.
Derrière l’aspect réglementaire, la RE 2028 / 2031 vise aussi à
structurer un modèle économique plus résilient : construction modulaire, maintenance prédictive, réemploi des matériaux, réduction des déchets.
Les entreprises capables d’intégrer ces dimensions seront les mieux positionnées pour répondre aux futurs appels d’offres publics, qui intégreront progressivement ces critères de durabilité.
Les principaux défis pour les professionnels
Si la transition vers la RE 2028 et la RE 2031 ouvre des perspectives, elle représente aussi un
changement profond des pratiques. Plusieurs défis se dessinent :
-
Montée en compétences : la compréhension des analyses de cycle de vie (ACV), des FDES ou des indicateurs carbone nécessite des connaissances techniques nouvelles.
-
Investissements matériels et logiciels : la généralisation du BIM, des simulateurs thermiques et des outils de suivi environnemental demande des ressources financières et du temps d’adaptation.
-
Approvisionnement et coordination : certaines filières (matériaux biosourcés ou recyclés) restent encore limitées en volume et en logistique.
-
Gestion des coûts et délais : la transition écologique impose d’innover sans compromettre la rentabilité ni les plannings de chantier.
Se former pour anticiper la transition
L’entrée en vigueur de la RE 2028, puis de la RE 2031, ne pourra être réussie sans une montée en compétences massive dans toute la filière du bâtiment. Les entreprises devront non seulement comprendre les nouveaux indicateurs environnementaux, mais aussi être capables d’en faire un
levier de performance et de différenciation.
Les compétences clés à maîtriser
Les exigences des futures réglementations imposent d’aller au-delà de la simple efficacité énergétique. Les professionnels doivent aujourd’hui intégrer une vision
globale du cycle de vie du bâtiment.
Cela implique de savoir :
-
Lire et interpréter les Analyses de Cycle de Vie (ACV), désormais incontournables pour démontrer la conformité d’un projet ;
-
Utiliser les Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) pour sélectionner les bons matériaux ;
-
Concevoir des bâtiments bioclimatiques, optimisant orientation, inertie et apports solaires ;
-
Intégrer la dimension carbone dans les choix techniques, dès la phase esquisse ;
-
Et, plus largement, travailler en approche intégrée, en collaboration étroite avec architectes, bureaux d’études et fabricants.
Ces savoirs ne concernent plus seulement les ingénieurs ou les concepteurs : ils touchent aussi les
conducteurs de travaux,
chefs de chantier et
artisans, qui doivent comprendre les impacts concrets des choix de matériaux et de procédés sur la performance environnementale finale.
Les dispositifs de formation disponibles
Face à cette mutation, l’offre de formation se structure rapidement. Les
organismes de formation spécialisés dans la construction durable (comme le Cnam, l’Afpa, ou les centres régionaux du réseau CIBC et Greta) développent des modules adaptés aux nouvelles exigences.
Les
CFA du bâtiment actualisent leurs programmes pour inclure la conception bas carbone, le réemploi ou la préfabrication. Les
écoles d’ingénieurs et d’architecture intègrent quant à elles des enseignements sur l’analyse environnementale, la simulation thermique dynamique et la gestion énergétique.
Pour les entreprises déjà en activité, la
formation continue devient essentielle : plusieurs opérateurs (Qualibat, Capeb, FFB, Envirobat, etc.) proposent des parcours courts ou certifiants. Certains labels comme
RGE évoluent également pour intégrer des modules sur la réduction du carbone et la gestion des déchets de chantier.
Valoriser les compétences acquises
Au-delà de la mise à niveau, la maîtrise de ces nouvelles compétences représente une
opportunité commerciale. Les maîtres d’ouvrage publics, bailleurs et promoteurs recherchent désormais des partenaires capables de prouver leur engagement environnemental.
Obtenir une
certification ou un label reconnu (type « Pro de la performance énergétique », « Bâtiment biosourcé » ou « Bas carbone ») devient un atout concurrentiel tangible. Ces reconnaissances permettent aussi de
sécuriser les marchés à venir, notamment dans le logement collectif et les bâtiments publics, premiers concernés par la RE 2028.
Les outils numériques indispensables
La réussite de la transition vers la RE 2028 et la RE 2031 passera inévitablement par la
maîtrise d’outils numériques avancés. Ces technologies permettent de simuler, mesurer et optimiser les performances environnementales dès la conception, tout en facilitant le suivi en phase chantier.
Le BIM au service de la performance environnementale
Le
BIM (Building Information Modeling) est devenu bien plus qu’un outil de modélisation 3D : il devient la colonne vertébrale du projet durable. Intégré aux exigences de la RE 2028, il permet de :
-
centraliser les données énergétiques et environnementales,
-
anticiper les impacts carbone des choix constructifs,
-
et suivre la conformité tout au long du cycle de vie du bâtiment.
Les versions les plus récentes du BIM intègrent désormais des
plug-ins ACV et des
bases FDES, facilitant l’évaluation du carbone incorporé directement dans la maquette numérique.
Simulations et calculs carbone
Les logiciels de
simulation thermique dynamique (STD) et de
calcul carbone deviennent essentiels pour justifier la conformité réglementaire. Des outils comme Pleiades, CYPE, ClimaWin ou Izuba ACV permettent de simuler les consommations d’énergie, le confort d’été et les émissions associées.
Grâce à ces solutions, les concepteurs peuvent comparer plusieurs variantes de conception (structure bois, béton bas carbone, isolation renforcée) et sélectionner celle qui présente le meilleur équilibre entre performance, coût et impact global.
Suivi et traçabilité sur le chantier
Sur le terrain, la digitalisation s’impose également. Les applications mobiles et plateformes collaboratives (comme Kairnial, Finalcad ou Sogelink) facilitent :
-
le suivi qualité environnementale,
-
la gestion des déchets et du tri,
-
la traçabilité des matériaux réemployés ou recyclés.
Certains maîtres d’ouvrage exigent déjà ces outils pour certifier la conformité environnementale des opérations. Cette traçabilité numérique devient un gage de transparence et une preuve de sérieux vis-à-vis des clients.
Vers un chantier connecté et mesurable
Enfin, la RE 2031 introduira la notion de
performance mesurée : il ne suffira plus de concevoir vertueux, il faudra
démontrer les résultats en exploitation.
Capteurs connectés, tableaux de bord énergétiques et plateformes de suivi permettront d’analyser les données réelles du bâtiment et d’ajuster les paramètres d’usage. Cette approche « as built » et « as used » transformera durablement la gestion post-livraison.
Les procédés constructifs à privilégier
L’application de la RE 2028 et de la RE 2031 ne se limite pas à une meilleure isolation ou à une optimisation énergétique. Elle impose une
révision profonde des modes constructifs, afin de réduire l’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment.
La préfabrication et la construction modulaire
La préfabrication en atelier et la construction modulaire gagnent du terrain. En limitant les déplacements sur chantier et les pertes de matériaux, ces procédés permettent de
réduire les émissions et d’améliorer la qualité d’exécution.
Les modules sont produits dans des environnements contrôlés, avec une précision accrue et un meilleur contrôle des déchets. Les délais sont réduits, et les opérations de chantier deviennent plus propres, plus sûres et plus prévisibles.
Les systèmes
bois,
bois-béton ou
acier léger s’adaptent particulièrement bien à ces méthodes, conciliant performance thermique, légèreté et rapidité de mise en œuvre.
L’essor des structures hybrides et bas carbone
Les procédés traditionnels, notamment en béton, évoluent eux aussi. L’émergence de
bétons bas carbone, de
liants alternatifs ou de
solutions bois-béton hybrides permet de réduire significativement les émissions liées à la structure, qui représentent souvent plus de la moitié de l’impact carbone d’un bâtiment.
Les solutions mixtes, combinant l’inertie du béton et la légèreté du bois, répondent efficacement aux exigences de confort d’été et de durabilité imposées par la RE 2031.
Conception réversible et économie circulaire
Un bâtiment conforme aux futures réglementations ne se pense plus comme un objet figé, mais comme un système réversible et adaptable. La
conception pour démontage permet d’anticiper la déconstruction, le réemploi et la valorisation des composants.
Ce principe, déjà expérimenté sur certains projets tertiaires, devrait s’étendre aux logements collectifs d’ici 2030. Les entreprises devront donc apprendre à
intégrer la circularité dès la conception : assemblages mécaniques plutôt que collés, structures démontables, matériaux identifiés et tracés.
L’optimisation thermique et le confort d’été
Enfin, les futures réglementations mettront également l’accent sur le
confort d’été, devenu un enjeu majeur face au réchauffement climatique. Les procédés constructifs devront limiter les surchauffes sans recourir systématiquement à la climatisation.
L’usage de
murs à forte inertie, de
protections solaires passives, de
ventilation naturelle ou encore de
toitures végétalisées sera encouragé. L’objectif : conjuguer performance énergétique, bien-être des occupants et réduction de la consommation d’énergie en période estivale.
Matériaux émergents et filières bas carbone
Les futures RE 2028 et RE 2031 inciteront fortement à
repenser le choix des matériaux. La performance énergétique ne suffira plus : il faudra démontrer une baisse mesurable de l’impact carbone global.
Les
matériaux biosourcés occupent une place centrale dans la stratégie bas carbone. Bois, chanvre, lin, ouate de cellulose, paille ou encore liège offrent d’excellentes performances thermiques tout en stockant naturellement du carbone.
Leur utilisation nécessite cependant de
maîtriser les spécificités techniques (hygrométrie, résistance au feu, durabilité) et de s’appuyer sur des filières locales capables de garantir la qualité et la régularité d’approvisionnement.
Bétons bas carbone et liants alternatifs
Le béton reste incontournable dans de nombreux projets, mais il doit évoluer. De nouveaux liants et formulations, ciments à faible teneur en clinker, bétons géopolymères, ou encore bétons de terre crue stabilisée, permettent de réduire l’empreinte carbone de
30 à 70 %.
Ces solutions, déjà testées sur certains programmes publics, seront amenées à se généraliser à mesure que les normes se précisent. Les entreprises devront se familiariser avec ces produits, leurs contraintes de mise en œuvre et leurs certifications à venir.
Réemploi et économie circulaire
La
RE 2031 renforcera la prise en compte de la fin de vie des matériaux. Les principes de
réemploi, de
recyclage et de
seconde vie deviendront incontournables.
Des plateformes comme Cycle Up ou Backacia facilitent déjà la revalorisation de composants (menuiseries, cloisons, isolants, équipements techniques) en leur offrant une traçabilité complète.
Cette approche circulaire demande une
coordination nouvelle entre concepteurs, entreprises et fournisseurs : les produits devront être conçus, identifiés et posés de manière à pouvoir être démontés sans être dégradés.
L’innovation comme moteur de filière
De nombreux matériaux émergents témoignent du dynamisme du secteur :
-
béton-chanvre,
-
panneaux en mycélium,
-
isolants à changement de phase,
-
enduits recyclés
Ces innovations ouvrent de nouvelles perspectives pour concilier performance, légèreté et faible impact environnemental.
Cependant, leur diffusion à grande échelle dépendra de la structuration des filières locales et de la
fiabilité technique des produits. Le rôle des industriels sera donc crucial pour standardiser, certifier et rendre disponibles ces solutions sur l’ensemble du territoire.
Article rédigé pour Batiactu par Rai d'Action.